Les Voix du peuple (1868). Impressions d’un condamné à mort (1871)
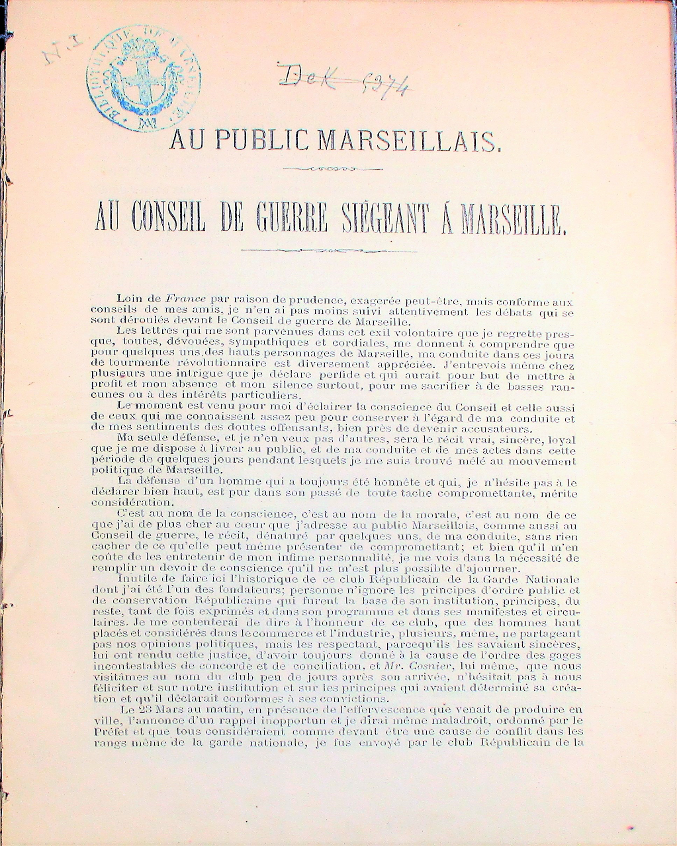
Loin de France pour des raisons de prudence, exagérée peut-être, mais conforme aux conseils de mes amis, je n’en ai pas moins suivi les débats qui se sont déroulés devant le Conseil de guerre à Marseille.
Les lettres qui me sont parvenues dans cet exil volontaire que je regrette presque, toutes, dévouées, sympathiques et cordiales, me donnent à comprendre que pour quelques-uns des hauts personnages de Marseille, ma conduite dans ces jours de tourmente révolutionnaire est diversement appréciée. J’entrevois même chez plusieurs une intrigue que je déclare perfide et qui aurait pour but de mettre à profit mon absence et mon silence surtout, pour me sacrifier à de basses rancunes ou à des intérêts particuliers.
Le moment est venu pour moi d’éclairer la conscience du Conseil et celle aussi de ceux qui me connaissent assez peu pour observer à l’égard de ma conduite et de mes sentiments des doutes offensants, bien près de devenir accusateurs.
Ma seule défense, et je n’en veux pas d’autres, sera le récit vrai, sincère, loyal que je me dispose à livrer au public, et de ma conduite et de mes actes dans cette période de quelques jours pendant lesquels je me suis trouvé mêlé au mouvement politique de Marseille.
La défense d’un homme qui a été longtemps honnête et qui, je n’hésite pas à le déclarer bien haut, est pur dans son passé de toute tache compromettante, mérite considération.
C’est au nom de la conscience, c’est au nom de la morale, c’est au nom de ce que j’ai de plus cher au cœur que j’adresse au public marseillais, comme aussi au Conseil de guerre, le récit, dénaturé par quelques-uns de ma conduite, sans rien cacher de ce qu’elle peut même présenter de compromettant, et bien qu’il m’en coûte de les entretenir de mon infime personnalité, je me vois dans la nécessité de remplir un devoir de conscience qu’il ne m’est plus possible d’ajourner.
Inutile de faire ici l’historique de ce Club républicain de la garde nationale dont j’ai été un des fondateurs ; personne n’ignore les principes d’ordre public et de conservation républicaine qui furent la base de son institution, principes, du reste, tant de fois exprimés dans son programme et dans ses manifestes et circulaires. Je me contenterai de dire l’honneur de ce club, que des hommes haut placés et considérés dans le commerce et l’industrie, plusieurs, même, ne partageant pas nos opinions politiques, mais les respectant parce qu’ils les savaient sincères, lui ont rendu cette justice d’avoir toujours donné à la cause de l’ordre des gages incontestables de concorde et de conciliation, et M. Cosnier lui-même, que nous visitâmes au nom de ce club peu de jours après son arrivée, n’hésitait pas à nous féliciter sur notre institution et sur les principes qui avaient déterminé sa création et qu’il déclarait conformes à ses convictions.
Le 23 mars au matin, en présence de l’effervescence que venait de produire en ville, l’annonce d’un rappel inopportun et je dirai même maladroit, ordonné par le Préfet et que tous considéraient comme devant être une cause de conflit dans les rangs mêmes de la garde nationale [1], je fus envoyé par le Club républicain de la garde nationale, auprès de M. Cosnier, en compagnie du docteur Gaillard et d’un autre membre dont le nom m’échappe, afin de solliciter dans l’intérêt de l’ordre public menacé, le retrait de cet ordre de rappel. M. Guibert, Procureur de la République, se trouvait auprès de M. Cosnier et il sut apprécier les intentions loyales de notre démarche. MM. Desservy, Abram, Pierre Pé, conseillers municipaux, délégués par le Conseil dans les mêmes intentions, nous trouvèrent à leur tour auprès du Préfet et joignirent eux aussi leurs pressantes sollicitations aux nôtres.
Le retrait fut accordé à nos instances collectives, avec prière d’user de toute notre influence pour calmer cette effervescence toujours croissante et déjà exploitée par les impatiences inconsidérées de quelques exaltés.
Il était près de midi quand nous sortîmes de la Préfecture, nous eûmes immédiatement le soin de convoquer le club de la garde nationale et ses délégués pour deux heures et demie, et nous nous rendîmes, avec le docteur Gaillard, au Cercle républicain du Midi, où pour la première fois je mettais les pieds, afin de faire connaître à ses membres la concession que nous venions d’obtenir de la Préfecture, concession qui à nos yeux devait suffire à calmer l’exaltation des plus ardents, nous eûmes le regret de voir nos communications repoussées par quelques-uns.
À deux heures et demie j’étais au club, j’avais hâte d’apaiser les esprits par le compte rendu de notre mission et par l’annonce que j’avais à faire des concessions obtenues, les moments étaient critiques, l’apaisement fut cependant complet ; la mission qui devait se rendre auprès de M. Cosnier, pour bien s’assurer que toute cause de conflit était écartée et pour demander en même temps communication des dépêches, que quelques esprits inquiets prétendaient être refusées au public. MM. Fraissinet, Pernessen et je crois M. Vidal, composèrent cette commission qui se mit immédiatement en marche pour la Préfecture ; inutile d’insister sur le caractère, la personnalité, la position commerciale et l’honorabilité de ces Messieurs.
Tous les délégués du club furent en même temps invités à porter sans retard à leurs compagnies respectives les sentiments du club et les décisions qui devaient faire cesser ce malentendu déplorable et dont nous ne comprenions que trop le danger.
La séance, suspendue momentanément, devait reprendre dès le retour de la Commission. Quant à moi, il était de mon devoir de rester au club déclaré en permanence ; c’est ce que je fis.
Vers les trois heures et demie, on vint nous prévenir que quelques groupes exaltés s’étaient emparés sans résistance de la Préfecture, suivis d’un certain nombre de gardes nationaux, auxquels s’était mêlé cet élément étranger dont la présence fut plus tard la principale cause des désastres dont notre ville a été le théâtre. Le Préfet était retenu prisonnier ainsi que son chef de cabinet et son Secrétaire.
Atterrés par cette nouvelle, qui nous fut confirmée et par plusieurs gardes nationaux et par les membres de la délégation, dont la mission avait été rendue impossible par cet envahissement que rien ne justifiait, nous continuâmes à délibérer sur la nouvelle situation en face de laquelle nous nous trouvions et qui venait de prendre un caractère de terrible gravité. À sept heures je sortais du club, j’y revenais à neuf heures, sans même être passé sur cette place de la Préfecture que l’on disait extrêmement mouvementée. Des résolutions sérieuses, énergiques devaient être prises, pour dominer un mouvement que repoussaient les sentiments presque unanimes de la garde nationale.
À peine arrivé, j’apprends que j’ai été désigné pour faire partie de la Commission installée à la Préfecture, et on m’invite à m’y rendre au plus tôt. Mon premier mouvement fut de refuser énergiquement, tous les membres présents en feront foi, un mandat si peu en rapport avec mon caractère et qui me semblait être complètement en désaccord avec l’attitude du club jusqu’à ce jour, et qui, en outre, me paraissait être une approbation de ce mouvement que nous avions unanimement condamné.
L’insistance de mes amis, la composition de cette Commission qui comprenait trois délégués du Conseil municipal et trois délégués du Club républicain de la garde nationale, la nécessité d’opposer à un élément révolutionnaire qui n’offrait pas à la garde nationale les garanties suffisantes, une délégation qui avait sa confiance et qui, avec l’appui de la Municipalité, donnait des gages certains d’ordre et de sécurité, me déterminèrent à accepter. On faisait appel à mon dévouement, je ne crus pas devoir en refuser le concours sincère et désintéressé. Je me rendis à la Préfecture, la Commission ne tarda pas à s’y trouver réunie.
Il est utile que je rappelle ici les scènes de désordre, que dès les premiers instants nous nous efforçâmes de réprimer, les violences incessantes que nous eûmes à supporter de ce milieu enfiévré, où l’élément étranger et exalté nous subissait avec une contrainte qui n’était même pas dissimulée.
Nous eûmes pourtant dès ce soir là, la satisfaction d’enlever aux violences de la Préfecture un négociant honorable, M. Roussier, arbitrairement arrêté et odieusement menacé, et de faire cesser, immédiatement, toute tentative d’arrestations nouvelles.
Nous comprîmes bien vite que nos efforts seraient rendus inutiles et impuissants si cette foule ardente et désordonnée continuait à séjourner dans cette Préfecture, où nos pouvoirs étaient méconnus et alors que nous n’avions même pas la satisfaction de délibérer seuls et à l’abri des menaces.
Du reste, ma première préoccupation en acceptant un mandat aussi difficile et dans des circonstances aussi critiques, fut de faire confier la garde de la Préfecture, exclusivement, à la garde nationale tout entière, seule et unique force sur laquelle nous pouvions nous reposer et dont nous étions, du reste, une émanation directe comme membres dévoués du Club républicain de la garde nationale ; et c’est pour arriver à un résultat aussi urgent, que le chef d’escadron d’état-major fut nommé colonel de la garde nationale, avec invitation pressante d’amener, sans retard, à la Préfecture, une force de vingt hommes par bataillon, ce qui formait un contingent d’environ trois cent cinquante hommes renouvelables toutes les vingt-quatre heures et offrant la garantie de famille, de position et de moralité, et qui seuls devaient rester en possession de la Préfecture.
Nous n’avions pas à rechercher ici les motifs qui, malgré le dévouement et la loyauté du colonel empêchèrent la garde nationale de se rendre à son appel et de nous aider de son puissant concours dans l’accomplissement du mandat qui nous avait été confié ; c’est du reste l’absence de ce concours qui nous fit retirer par le Club républicain de la garde nationale, la mission dont il nous avait investis à la première heure.
C’est aussi l’absence de ce concours, et par suite notre malheureuse impuissance au milieu de ce déplorable désordre qui rendit impossible l’élargissement tant désiré par nous tous, et du Préfet et de ses Secrétaires ; le tenter dans des moments aussi fiévreusement agités et alors que le mot de trahison commençait déjà à se faire entendre au milieu de cette foule si désordonnée et si peu Marseillaise, eut été les exposer aux violences des plus exaltés.
Il faut ne pas vouloir se rendre compte d’une situation semblable, pour nous faire aujourd’hui un crime de certaines mesures qui en temps ordinaires, je le veux bien, pouvaient être illégales, mais qui dans des moments aussi violemment tourmentés, ne pouvaient être que des mesures de conservation et d’ordre public.
On m’accuse d’avoir signé un ordre au chef de gare de livrer et de faire porter à la Préfecture les armes déposées à la gare, et on ne tient aucun compte des sentiments qui ont dicté un ordre semblable.
Les armes qui nous étaient signalées en gare ne se trouvaient pas suffisamment garanties d’un coup de main qui était à craindre, et leur transport à la Préfecture, où elles devaient se trouver sous la sauvegarde de cette garde nationale sur le concours de laquelle nous comptions tant, et dont nous avons réclamé avec confiance la puissante et immédiate intervention, devait aussi les mettre à l’abri de tout enlèvement. C’est là ce qui explique cet ordre si tristement apprécié par nos accusateurs.
C’est, du reste, le même sentiment qui me fit délivrer à quelques dévoués gardes nationaux du quartier de Menpenti, envoyés auprès de nous en délégation, pour nous mettre en garde contre la possibilité d’un envahissement des ateliers des forges et chantiers, où des armes étaient emmagasinées, un ordre complètement écrit de ma main et portant ma signature, invitant ces braves citoyens à se réunir d’urgence et en force pour protéger cet établissement et les armes qu’il renfermait, contre l’enlèvement menaçant d’une partie de la population étrangère à la cité et qui ne s’est que trop mêlée à ce mouvement, qu’il nous eût été plus facile d’apaiser sans son intervention coupable. Cet ordre peut encore se retrouver, je l’espère, entre les mains de ces travailleurs, qu’un noble sentiment de devoir et de conservation conduisait vers nous.
Je ne parlerai qu’en passant, de ces fameux boulets débarqués à la Joliette et destinés à la fonderie Bénet pour la refonte, et qui sans doute, dans un but de satisfaction ridicule, mais peut-être nécessaire, en présence de l’émotion de quelques citoyens irréfléchis, furent conduits à la Préfecture.
Un agent du bateau transporteur, peut-être même le vendeur, vint à la Préfecture supplier, pour sa garantie personnelle, que décharge lui fut donnée de ces boulets entassés dans la cour. Il était impossible de refuser à cet agent la décharge qu’il demandait et qui n’était du reste que la constatation d’un fait dont il n’était certainement pas responsable. Pour sortir cet agent de l’embarras dans lequel il se trouvait au milieu de cette Préfecture soulevée, je n’eus aucune appréhension à déclarer, et autant que je puisse m’en souvenir, sur le dos même du connaissement, qu’en effet une partie des boulets (nous n’en connaissions pas le nombre) se trouvait dans la cour de la Préfecture.
Incriminer une pareille déclaration ne me paraît pas plus sérieux que le transport lui-même et le dépôt à la Préfecture de ces bien inoffensifs boulets.
On pourrait peut être aussi me reprocher un ordre adressé au Directeur du télégraphe, et dont je suis peut-être un des signataires, de faire passer immédiatement à la Préfecture les dépêches ayant un caractère public.
Du moment où dans un tel but de sage direction, nous n’avions pas hésité à mettre notre dévouement au service de cette grande cause d’ordre public si gravement compromise, une mesure semblable n’avait rien de si révoltant, que l’on puisse aujourd’hui nous en faire crime. Ces dépêches étaient indispensables pour assurer la marche des services publics qui, par le fait même de ces événements auxquels nous n’avions en rien participé, se trouvaient entièrement désorganisés, ou du moins dévoyés ; et c’est là ce qui explique cette mesure que je reconnais illégale mais qui était aussi fatalement nécessaire.
Faut-il aussi que je m’explique et que je me défende à propos d’un bon pour un repas portant ma signature et donné à un de ces malheureux qui n’avait rien mangé depuis la veille. Mais notre rôle de conciliateurs pouvant amener un apaisement tant désiré, devrait excuser une faiblesse sans importance, d’autant que j’ai aussi formellement et sans pitié, refusé des secours en argent et en nourriture à de prétendus garibaldiens arrivés en nombre de Menton et qui, malgré leur insistance me trouvèrent inébranlable dans mon refus.
Que l’on se rappelle le peu de temps que je suis resté dans cette Préfecture, pas même vingt-quatre heures, et que l’on se rende compte de la situation critique qui nous y était faite, que l’on apprécie les regrets et les dégoûts que j’éprouvais déjà de cette situation, et à cet effet, je fais appel au souvenir de M. Allard, contrôleur d’armes, de M. Armelin, Secrétaire du Préfet, de M. Laur, ingénieur de la défense, dont les noms me viennent à la mémoire, tous citoyens des plus honorables et qui purent constater à la Préfecture, où je ne les vis qu’un instant, l’écœurement que je ressentais déjà, et qui du reste ne justifie que trop mon acceptation de délégué à Paris, lorsque le lendemain de l’envahissement, cette idée de délégation fut émise en dehors de cette commission par un groupe d’amis n’en faisant point partie et qui à ce moment, se trouvait avec nous à la Préfecture.
Marseille, comme toute la France, ignorait la portée du mouvement parisien ; les noms les plus inconnus figuraient seuls comme promoteurs de ce mouvement. Nous ne retrouvions au bas des proclamations que nous apportaient les journaux aucun de ces noms aimés et respectés en démocratie. Notre conscience républicaine était complètement dévoyée, et dans ce mouvement marseillais que nous avions été impuissants à arrêter, malgré tous nos efforts, et que nous eûmes par dévouement à diriger, après le fait accompli, en dehors de nous, de l’envahissement, que nous nous trouvions dans cette situation extrêmement critique, d’ignorer jusqu’à la portée du mouvement de Paris, que l’on affirmait être, cependant, un mouvement purement communal.
C’est vers les onze heures du matin qu’il fut question de l’envoi de délégués à Paris ; mais y eut-il à ce sujet délibération de la Commission, instructions données, mandat… ? Y eut-il seulement accord entre les membres de cette commission ? Non, rien de tout cela.
Je me trouvais en ce moment, dans cette salle soi-disant réservée à nos délibérations et toujours envahie ; M.
Il fut question entre nous, de l’envoi de délégués, non pas de la Commune qui n’existait même pas et dont on ne pouvait guère prévoir l’existence prochaine, mais à Paris.
Plusieurs amis de M. Audiffrend mirent unanimement son nom en avant pour cette délégation ; inutile de dire que son nom fut immédiatement accepté. Quant à moi, désillusionné déjà par l’absence de la garde nationale qui semblait nous refuser son concours, je n’hésite pas à déclarer, que je m’offris pour ce voyage à Paris en compagnie du docteur Audiffrend. Une réquisition pour le chemin de fer et comprenant deux noms, fut dictée par M.
Traversant la place peu d’instants après, je rencontrai M. Audiffrend entouré de ses amis MM. Barthelet, Négrin, Grimanelli, Vernet, Mose et Jules Maurel ; je n’eus même pas à entretenir M. Audiffrend de ce qui venait de se passer, il en était instruit par ses amis, nous nous contentâmes de prendre rendez-vous pour le soir à la gare.
Je m’y rendis en effet ; et avant même d’y avoir rencontré M. Audiffrend, j’avais eu le soin de prendre un billet pour Paris, sans tenir compte d’une réquisition dont je ne voulais pas user et que du reste, je l’avoue, je trouvais compromettante. En me retrouvant avec M. Audiffrend, je lui fis part de ma détermination. Lui-même, de son côté, avait également pris un billet ; la réquisition fut complètement abandonnée.
En nous rendant à la salle d’attente, je serrai la main à M. Pirodeau, qui se trouvait par hasard à la gare avec sa famille.
Nous partîmes ensemble avec M. Audiffrend, et bien entendu sans mandat, sans mission d’aucune espèce, sans la moindre lettre d’introduction pour n’importe qui.
Je n’ai pas à parler d’une troisième personne qui vint nous surprendre dans notre wagon, au moment du départ, et qui n’avait rien de commun avec notre délégation improvisée, mais qui comme nous, se rendait aussi à Paris.
À Lyon, dans l’intervalle de deux trains, nous nous informâmes de l’état de la ville, qui nous avait été annoncée en révolution ; tout était rentré dans l’ordre. Préfet et municipalité étaient à leur poste. Nous en informâmes, par lettre, nos amis de Marseille. On pouvait peut-être tenter de mettre à profit auprès des hommes qui étaient les maîtres réels de la Préfecture, l’annonce de ce calme, pour obtenir, ou tout au moins demander, la liberté de M. Cosnier et de ses secrétaires, liberté que la Commission n’avait pas pu décréter, par crainte des violences auxquelles auraient été exposés ces fonctionnaires.
Nous continuâmes notre voyage sur Paris. En route, les rapports de voyageurs que nous consultâmes nous firent hésiter à continuer notre voyage qui pourtant s’accomplit sans incident.
N’ayant aucun hôtel de préférence, je suivis M. Audiffrend dans l’hôtel de son choix, rue Jacob, hôtel de Saxe. Je me fis inscrire sous le nom de Charles Durand, qui est celui de ma mère. J’étais parti sans prévenir ma Compagnie, je tenais essentiellement à lui cacher mon absence, qui aurait pu être divulguée par quelque rapport de police ou par quelque indiscrétion des journaux de Paris ; et puis, du reste, je reconnaissais très bien que je n’étais pas à Paris dans une position précisément légale, mais notre situation à la Préfecture de Marseille ne l’était pas davantage ; ce que je savais avant tout, c’est que nous pouvions contribuer par nos appréciations sincères, à faciliter à Marseille la conciliation qui était dans tous les esprits.
Il fut convenu avec M. Audiffrend que chacun de notre côté nous nous entourerions des renseignements les plus exacts, les plus précis et qui, puisés à diverses sources, nous mettraient à même de nous rendre un compte exact de la véritable portée de ce mouvement.
La Commune n’existait pas encore, le Comité Central seul était à l’Hôtel de Ville et je dois avouer que l’appréciation générale des Parisiens était loin d’être défavorable à ces premiers agissements. On avait encore à ce moment la conviction intime que ce Comité était purement municipal et que l’entente avec Versailles ne pouvait tarder de se faire sur le programme des libertés communales.
Je n’ai pas à cacher les personnages politiques que je vis pendant mon séjour à Paris. MM. Floquet, Desonnaz, de L’Avenir National, les rédacteurs du journal La Cloche, M. Delescluze dont j’estimais le caractère sans le connaître et qui n’hésita pas à se déclarer ennemi de l’Internationale qu’il refusait à prendre au sérieux. M. Delescluze était encore simple journaliste et se disposait à reprendre la publication du Réveil. M. Viard, du Comité central, fanatique de l’Internationale, et qui me donna à connaître le récent départ pour Marseille des délégués de l’Internationale ; bien fâcheuse nouvelle qui me laissait entrevoir de graves et sérieuses complications dans notre cité.
En dehors de ces hommes politiques, je vis également un membre correspondant d’un journal modéré de notre ville, le docteur Sollier de Marseille, rentré à Paris auprès de sa famille, M. Dubuis, notre très honorable et très dévoué conseiller municipal que je savais en tournée commerciale avec son représentant, homme d’une sagesse et d’une modération extrême, et avec eux deux autres négociants marseillais dont les noms m’échappent, présents à Paris pour affaires commerciales. J’ajouterai même que pendant mon court séjour je pris, pour ainsi dire, tous mes repas en compagnie de ces cinq personnes.
Paris était parfaitement calme, les barricades se démolissaient, la circulation était redevenue complètement libre, le mouvement aussi grand que dans les jours les plus prospères.
Mes premières impressions, conformes du reste à celles du docteur Audiffrend, que je revoyais tous les matins à l’hôtel, impressions puisées à d’autres sources et auprès d’hommes politiques très honorables, et de négociants très respectables, nous permettaient d’espérer que la conciliation entre Paris et Versailles était inévitable en présence de la presque unanimité de Paris, dans sa revendication des libertés communales ; et c’est dans ce sens que j’écrivais à Marseille, non à la Commission, mais à un ami.
Cependant la modération du Comité central n’était qu’apparente et bientôt ses projets de gouvernement allaient se dévoiler.
La Commune fut nommée pendant que nous étions à Paris, je ne vis aucun de ses membres. Plus de cent cinquante mille gardes nationaux, pleins de confiance dans une solution conciliatrice prochaine, défilèrent sur les boulevards et sur la place de l’Hôtel de Ville ; cette unanimité ne devait pas être de longue durée. La démission de plusieurs membres de la Commune, les prétentions du Comité central, ses aspirations gouvernementales partagées par un grand nombre des élus, aspirations que j’avais déjà cru entrevoir, mais auxquelles j’avais préféré ne pas croire encore, tout cela me faisait redouter pour un avenir prochain, un conflit des plus graves, j’en fus épouvanté et, du reste, je ne faisais que partager l’épouvante de M. Floquet que je revis et de mes compagnons de table et de M. Audiffrend qui lui aussi partageait les mêmes craintes.
Je fis part de ces craintes, non pas à la Commission de Marseille, avec laquelle je n’avais aucune relation, mais à un ami. Je lui laissai entrevoir une division prochaine de la garde nationale de Paris et je n’hésitai pas à déclarer que ces tendances gouvernementales étaient grosses de dangers, menaçantes d’éventualités, et devaient amener une scission complète parmi les gardes nationaux. Ces impressions furent communiquées au Club républicain de la garde nationale.
M. Audiffrend avait écrit dans le même sens à ses amis de Marseille.
Nous partîmes de Paris ensemble et nous arrivâmes ensemble à Marseille.
Nous étions restés à Paris en observateurs, aucun acte d’hostilité envers le gouvernement de Versailles ne saurait donc nous être reproché, nous n’en avions ni la possibilité et encore moins le mandat.
À Marseille, tout était changé. Le Conseil municipal avait retiré ses délégués de la Préfecture, le Club républicain de la garde nationale en avait fait autant, et M. Landeck, délégué de Paris, dont j’entendais le nom pour la première fois, avait en main la direction du mouvement.
Notre devoir cependant était de faire connaître à M. Crémieux les impressions que nous rapportions de Paris. Nous nous rendîmes à la Préfecture dans l’après-midi, et sans tenir compte de la présence de M. Landeck, M. Audiffrend, plus autorisé que moi et par son âge et par sa position, fit part à M. Crémieux de nos impressions communes.
La narration fidèle de voyage, rédigée par M. Audiffrend, et qui me fut communiquée par lui, devait être livrée à la publicité, je regrette qu’il n’en ait pas été ainsi. Je suis convaincu que la franchise de ce récit m’eût épargné les doutes que ce voyage paraît avoir laissés dans l’esprit du Conseil de guerre, comme aussi dans celui de quelques rares personnages de Marseille.
Depuis ce jour, je n’ai plus paru à la Préfecture qu’une seule fois. La présence de M. Landeck rendait toute conciliation impossible, et cependant, atterrés par les prévisions sinistres qui ne devaient que trop tôt se réaliser, nous tentâmes un dernier effort. Il nous fut impossible de voir M. Crémieux, nous soupçonnâmes M. Landeck de cet empêchement, mais nous n’en déclarâmes pas moins à ce Monsieur qu’il se faisait complètement illusion sur les dispositions de la garde nationale ; ce fut surtout M. Chazal, brave et loyal citoyen, qui n’hésita pas à déclarer à M. Landeck que la garde nationale se refuserait à le suivre dans la voie déplorable dans laquelle il s’était engagé et qui devait fatalement nous conduire aux funestes journées du 4 avril. M. Landeck fut inébranlable dans son sinistre entêtement. Nous comprîmes que notre rôle de conciliateur était devenu à jamais impuissant, et, désespérés, nous nous bornâmes à faire part au Conseil municipal du triste résultat de cette dernière tentative dont, du reste, nous l’avions prévenu.
Et maintenant cette accusation de complicité avec la Commune de Paris pourrait-elle être maintenue à mon égard par le Conseil de guerre de Marseille. Mais si cette complicité eût existé, je n’aurai pas fui la Préfecture, malgré l’insistance pour m’y retenir de plusieurs membres de la Commission transformée, et qui prétendaient que ma démission n’avait pas été donnée. Je n’avais du reste pas à la donner et à occuper le public de ma personnalité ; la garde nationale m’avait envoyé à la Préfecture, elle m’en avait retiré, ça me suffisait[2]. Je n’aurai surtout pas abandonné la Préfecture au moment de mon retour, et alors que la Commune de Paris se croyait si puissante, et que c’était le moment le plus réel de son triomphe [2]. Je n’aurai pas, en plein club, affirmé mes pressentiments déjà exprimés, de tendances gouvernementales de la Commune et de ses dangers ; affirmation qui répondait à la sincère et loyale appréciation de l’un des membres du club qui, lui, ne pouvait pas croire encore, aux intentions gouvernementales de la Commune.
Ma conduite, avant comme après ou même pendant ce voyage, mes déclarations, mes tentatives de conciliation et mon passé tout entier, protestent contre cette accusation de complicité.
Après la déchirante journée du 4 avril, je suis resté à Marseille à mes affaires jusqu’au 16. Ma Compagnie m’attendait depuis quelques jours à Bordeaux pour avoir des explications sur ma conduite ; je ne voulais pas que l’on pût croire que je fuyais le Conseil de guerre dont on me disait menacé, je dus cependant me rendre à son invitation. Mes explications furent admises par mes chefs, j’avoue cependant, que je leur laissai ignorer mon voyage à Paris dont je reconnaissais l’irrégularité au point de vue administratif. Une mission d’étude dans les Pyrénées me fut confiée par ma Compagnie ; je me rendis à Bayonne, Hendaye, Irun (Espagne) où j’aurai pu m’arrêter si j’avais eu la moindre appréhension. Pau, Tarbes, etc. etc. Je revenais sur Marseille, lorsque le 27 avril à Montpellier, où je m’étais arrêté pour quelques heures seulement, avis me fut donné par mes amis de Marseille qu’un mandat d’amener était lancé contre moi et on me conseillait en même temps de me tenir momentanément à l’écart.
J’étais peu disposé à écouter, à ce moment, de semblables conseils, tout dévoués qu’ils fussent, et mon premier mouvement fut de continuer ma route sur Marseille.
Cependant, la triste perspective d’une prévention qui pouvait être de longue durée et qui devait jeter ma famille dans des tourments que je voulais à tout prix lui éviter, l’insistance de mes amis, me décidèrent à tenir compte de leurs conseils.
Je restai à Montpellier, allant tous les jours à la gare chercher les journaux de Marseille, circulant dans toute la ville, écrivant à mes amis de Marseille, ne tenant aucun compte des recherches dont je pouvais être l’objet.
Je suis resté dans cette situation jusqu’au 24 mai.
J’avoue qu’à cette date, les horribles événements de Paris( [3]), qui soulevèrent à juste titre l’indignation générale, m’épouvantèrent. Le Conseil de guerre, sous l’impression de ces événements pouvait être d’une sévérité irréfléchie, impitoyable pour tous ceux indistinctement, qui s’étaient trouvés mêlés au mouvement de Marseille, j’en fus épouvanté, je le répète, et je me réfugiai à l’étranger.
Le récent acquittement de M.
J’apprends aujourd’hui, que ce voyage à Paris, indignement et perfidement dénaturé par quelques personnes étrangères au Conseil dans son but et même, paraît-il, dans ses résultats, m’est incriminé tout particulièrement et que dans la pensée du Conseil de guerre la culpabilité qui se rattache à ce voyage est des plus graves.
La sincérité de mon récit fera disparaître, je l’espère, tous les doutes du Conseil sur l’importance qu’il attribue à ce voyage complètement inoffensif.
Cependant, la menace d’une prévention que l’on m’assure être excessivement pénible et souffrante, la conscience de mon innocence, les déchirements à épargner à ma famille et les conseils de mes amis les plus dévoués me déterminent à attendre encore à l’étranger, l’apaisement des esprits, qui amènera, j’en suis certain, à une appréciation plus saine et plus impartiale de ma conduite.
En résumé, je suis resté moins de vingt-quatre heures à la Préfecture, et si, dans ce court espace de temps, j’ai pris part à certaines mesures dont j’ai accepté la responsabilité et que je considérais comme fatalement nécessaires dans un moment de fiévreuse tourmente, je n’ai agi que sous l’inspiration des sentiments de conservation, de sécurité et d’ordre public, qui sont les principes mêmes de ma foi républicaine.
J’ai fait un voyage à Paris en simple observateur, sans mandat, sans mission et qui défie toute insinuation calomnieuse, perfide ou intéressée.
Et, en ce qui concerne ma conduite dans ces jours néfastes, je n’admets, je l’ai déjà dit, qu’un seul regret, c’est que tous n’aient pas tenté de remplir, comme je l’ai tenté moi-même, un devoir sacré de dévouement, rendu impuissant par l’indifférence du plus grand nombre. La France républicaine n’eût pas eu à déplorer les terribles événements dont Paris et Marseille ont été le théâtre.
Tel est l’exposé que je livre au public et au Conseil de guerre ; quelques détails m’échappent peut-être, ils ne sauraient être qu’insignifiants et sans importance.
Mais, par ce que j’ai de plus cher au monde, par les souvenirs sacrés qui furent les rêves de ma vie, j’affirme que cette longue narration est l’expression précise et détaillée des sentiments et des faits que dans ma conscience républicaine je n’hésite pas à soumettre à l’appréciation réfléchie de mes concitoyens et de mes juges du Conseil de guerre.
Ch.
[1]
[2] Cartoux était de retour à Marseille le 29 mars 1871, période à laquelle la Commune de Paris était effectivement à son apogée et qu’il aurait pu alors soutenir, mais dont il dénigra au contraire les tendances gouvernementales.
[3] Le 24 mai 1871, alors que l’Hôtel de Ville de Paris, abandonné et incendié par les communards, se consume toujours, les Versaillais prennent d’assaut le quartier latin où ils commettent des exécutions auxquelles les communards répondent par plusieurs exécutions, notamment celle de l’archevêque Darboy.